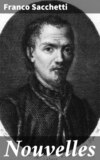Читать книгу: «Curiosa», страница 7
XIV
ROLAND FURIEUX
POÈME DE L’ARIOSTE49
Traduire l’Arioste, suivre dans ses méandres cette infatigable et prestigieuse imagination, c’est un travail de plus d’attrait que de fatigue. Après le plaisir de créer et de douer de vie ses propres conceptions, plaisir qui doit être intense, mais qui n’est pas pour tout le monde à portée de la main, il n’en est peut-être pas de plus grand que de s’attacher à l’œuvre d’un tel maître, de la revivre, pour ainsi dire, avec lui, et d’essayer d’en donner une copie fidèle.
Cette tâche a séduit bien des gens de talent et de mérite, depuis le vieux Jehan des Gouttes qui, dès 1543, a montré à tous le chemin, jusqu’à MM. Du Pays, C. Hippeau et Marc Monnier, qui nous précèdent immédiatement. Dans l’intervalle, Mirabaud, Creuzé de Lesser, Duvau de Chavagne, le comte de Tressan, Delatour, Philippon de la Madelaine, Panckoucke et Framery, M. Desserteaux s’y sont exercés tour à tour, soit en vers, soit en prose, et y ont usé quelque chose de leur existence: car ce n’est pas une mince affaire que reprendre vers par vers un poème qui en compte cinquante mille, et il faut que le traducteur, en se mettant à une telle besogne, se sente soutenu d’un peu de cette foi qui, dit-on, transporte les montagnes. Chacun d’eux a cru faire mieux que ses devanciers: ce sera notre excuse d’être venu à leur suite, et si nous n’avons mieux fait, au moins aurons-nous fait autrement.
Des essais de traductions poétiques, le dernier, celui de M. Marc Monnier (le Roland de l’Arioste raconté en vers, 1878), est le plus agréable. En choisissant dans l’œuvre entière les épisodes qui lui convenaient, ceux où Roland est en scène, non pour les faire passer littéralement dans notre langue, mais pour en extraire le suc, en prendre la fleur, l’auteur, un homme d’esprit, qui parfois en prête même à l’Arioste, a mieux que tout autre réussi à rendre le génie du poète, sa libre allure, sa légèreté de touche et ce mélange d’enjouement et de sérieux qui est sa caractéristique. Le vers de dix pieds, substitué au monotone Alexandrin, la forme de la strophe, qui rappelle l’octave Italienne, font presque illusion. Mais c’est là un aimable et savant badinage inspiré par l’Arioste, plutôt que l’Arioste en personne; il y est trop vu en raccourci. Dans le Roland furieux, Roland n’est, malgré le titre, qu’au second plan, et comme épopée, ce qui distingue celle-ci entre toutes, c’est qu’elle n’a ni action principale, ni héros qui prime ses voisins (si elle en avait un, ce serait Roger), ni but autre que d’enchanter et de divertir. Son intérêt est dans cette succession d’épisodes à peine reliés entre eux, dans ce chassé-croisé d’aventures et de personnages qui se cherchent, se rencontrent, se perdent, se retrouvent, au grand amusement du poète, qui n’a jamais assez de fils pour ourdir sa vaste toile, et du lecteur, qui ne se lasse pas de le suivre dans le libre champ de sa fantaisie.
Les traductions en prose, quoique généralement bien pâles et bien effacées, donneraient donc encore l’idée la plus vraie du poème, si elles n’avaient le grave défaut d’accréditer cet ancien préjugé, que traduction et ennui sont une seule et même chose sous deux noms différents. On a oublié celles de Mirabaud et du comte de Tressan; elles appartiennent à ce genre faux qui sacrifie au prétendu bon goût les comparaisons luxuriantes, les métaphores hardies, tout ce qui constitue le nerf, l’originalité du style, et les remplacent par de pauvres fleurs fanées de collège. Les plus récentes, d’un exact et consciencieux travail, restent encore bien loin de l’original, dont la poésie s’est comme évaporée dans le passage d’une langue à l’autre; aussi a-t-on été amené à les aider du secours de l’illustration, à faire disparaître le texte sous les images.
Nous n’avons pas voulu nous priver entièrement de ce précieux auxiliaire, mais sans lui donner une part prépondérante. En tête de chaque chant, de vieux bois d’une ancienne édition de Venise50, finement et savamment gravés à nouveau par M. A. Prunaire, ornent le texte sans l’absorber, sans faire passer la curiosité des yeux avant celle de l’esprit.
Au vers, qui impose toujours une gêne, qui force à des compromis et ne se pénètre plus intimement de la poésie du modèle qu’aux dépens de la littéralité; à la simple prose, muse pédestre, bien traînante et bien terre à terre pour suivre dans son vol le plus capricieux des poètes, nous avons préféré le système de traduction linéaire dont M. Léon de Wailly a donné dans son Robert Burns un excellent modèle, et qui se plie, comme le vers, aux inversions, aux tournures poétiques, aux hardiesses de langue, sans l’embarras du rythme, de la rime et de la césure. Une traduction n’est toujours qu’un reflet; Rollin disait: l’envers d’une tapisserie. Comparons celles qui sont obtenues par cette méthode à une image projetée dans l’eau et dont certains détails peuvent être affaiblis, mais qui conserve ses lignes et ses contours: le texte placé en regard aidera à la similitude. Arriver à ce que l’œuvre primitive se dessine aussi exactement dans la traduction qu’un objet placé devant un miroir, ce serait la perfection, et elle n’est pas de ce monde. Mais le lecteur a l’un à côté de l’autre le texte et sa reproduction; d’un seul coup d’œil il pourra rectifier celle-ci et lui rendre ce qui lui manque, si le miroir est un peu terne, si l’image y a perdu quelqu’une de ses vives couleurs.
Septembre 1879.
XV
DES HERMAPHRODITS
PAR JACQUES DUVAL51
Le traité des Hermaphrodits, du vieux médecin Rouennais Jacques Duval, est depuis longtemps classé parmi ces livres curieux et rares que les bibliophiles aiment à posséder et peut-être à lire. La singularité du sujet, que personne encore n’avait étudié si à fond et que l’auteur sut étendre bien au-delà de ses limites naturelles, lui valut au XVIIe siècle une renommée assez grande; la bizarrerie et la naïveté du style, les étonnants développements donnés à certains détails physiologiques, la lui ont conservée jusqu’à nos jours. Un médecin qui aujourd’hui reprendrait ce thème le traiterait sans doute autrement, sur des bases plus certaines et à l’aide d’observations mieux contrôlées; il ferait un livre plus scientifique, mais à coup sûr moins divertissant.
Jacques Duval n’est guère connu que par cet ouvrage. Il est en outre l’auteur d’une Hydrothérapeutique des fontaines médicinales nouvellement découvertes aux environs de Rouen, Rouen, 1603, in-8o; d’une Méthode nouvelle de guérir les catarrhes et toutes les maladies qui en dépendent, Rouen, 1611, in-8o; et d’une Réponse au discours fait par le sieur Riolan contre l’histoire de l’hermaphrodit de Rouen, Rouen, 1615, in-8o. On lui reproche généralement de s’être montré trop crédule, d’avoir accueilli sans examen quantité de fictions et de fables puériles, de faits controuvés et d’opinions ridicules. C’est la science incomplète et pédante de son temps qui en est cause; un des chapitres du livre, celui où il explique à l’un des Conseillers de la Cour les motifs de son rapport, dans la cause de ce fameux hermaphrodite de Rouen, rappelle étonnamment la phraséologie des médecins de Molière. En le lisant attentivement, on s’aperçoit d’ailleurs qu’il rejette au moins autant d’erreurs qu’il en admet et que, de celles qu’il adopte, la plupart ne lui appartiennent pas en propre: Cardan, Paracelse y avaient fait croire avant lui. Au point de vue historique, les extravagantes données sur lesquelles reposait l’ancienne médecine ont leur intérêt; elles font apprécier le chemin parcouru depuis et le génie persévérant de ceux qui osèrent rompre avec une routine consacrée par tant de vieux textes, tant d’autorités en apparence si inébranlables.
La singulière occasion qui lui mit la plume à la main, montre précisément qu’il n’était pas l’esclave des sots préjugés de son époque. Un pauvre diable, victime d’un vice de conformation assez rare, après s’être cru longtemps femme et avoir passé la moitié de sa vie comme chambrière dans diverses maisons, s’aperçoit un beau jour qu’il a tout ce qu’il faut pour être homme; une jeune veuve qu’il courtise est de son avis et ne trouve aucune différence appréciable entre l’ex-chambrière et son défunt époux. Sa décision aurait dû suffire; mais l’Église, pas plus que les Parlements, n’était bien tendre pour les disgraciés de la nature, et les individus d’un sexe indécis se trouvaient spécialement voués à l’anathème comme fils ou suppôts de Satan. Riolan, médecin de Marie de Médicis, celui-là même à qui J. Duval adressa la Réponse citée plus haut, Riolan croyait être bien hardi en établissant que l’on peut se dispenser de faire périr les géants, les nains, les sexdigitaires, les individus à tête disproportionnée, et qu’il suffit de les reléguer loin de tous les regards: cela semblait une nouveauté bien paradoxale. Quand l’homme en question s’adressa, pour avoir dispense de se marier, au Pénitencier de Rouen, il fut déféré à Justice et le procureur du roi conclut bel et bien à ce qu’on le brûlât vif, sans autre information; tout ce que les juges purent faire, ce fut de commuer le bûcher en la potence. Cependant, le misérable en appela, la Cour ordonna qu’il serait examiné, chose que l’on avait négligée comme superflue, et, par bonheur pour lui, Jacques Duval fut un des dix médecins, chirurgiens et sages-femmes jurées commis à cet effet. Tandis que tous ses confrères et les vieilles matrones elles-mêmes, arrêtés par une pudeur bien surprenante, se contentaient de regarder de loin le monstre et, ne voyant rien, déclaraient que le prétendu hermaphrodite était une ribaude bonne à pendre, Duval, plus entreprenant, mit les doigts où il fallait pour s’assurer de la vérité du fait, et se convainquit d’avoir affaire à un androgyne ou gunanthrope intermittent. Il ne put triompher de la répugnance de ses confrères, qui s’obstinèrent, malgré ses supplications, à garder leurs mains dans leurs poches; mais son rapport décida la Cour, qui renvoya l’hermaphrodite absous et lui permit plus tard d’épouser la veuve.
Fier, et à bon droit, d’un résultat pareil, Jacques Duval ne voulut pas en laisser périr la mémoire. Il composa donc tout exprès ce livre, pour lequel il colligea diligemment tous les exemples d’hermaphroditisme qu’il put rencontrer, tant dans la Fable que dans les auteurs, depuis Adam, qu’un verset de la Genèse dit avoir été créé homme et femme, jusqu’à Marin le Marcis, l’intéressant gunanthrope soumis à son examen. Cela le conduisit à parler d’autres monstruosités non moins curieuses: du noble Polonais à qui survint une dent d’or, de l’homme qui, à force de vivre dans les bois, se vit pousser des cornes de cerf sur la tête, de la jeune fille qui avait, au lieu d’ongles, des tuyaux de plumes de cygne, et d’une foule d’autres belles histoires. Pour se rendre compte de toutes ces anomalies, encore faut-il avoir quelques notions du corps humain à l’état normal et spécialement, pour le cas ambigu de Marin le Marcis, des parties destinées à la génération chez l’homme et chez la femme; Duval exposa donc doctoralement tout ce que de son temps on savait là-dessus, et, comme la matière est intéressante, il y ajouta par surcroît quelques bons chapitres sur les signes de pucelage et les signes de défloration, la membrane hymen, le déduit vénérien, les grossesses, les accouchements, avec force recommandations à l’adresse des sages-femmes ignares et négligentes; il fit de son livre un traité presque complet d’anatomie et un manuel d’obstétrique. Enfin, ne voulant rien oublier, il chercha dans l’astrologie la cause efficiente des malheurs du pauvre gunanthrope et ne manqua pas de la trouver: le malin Mercure, la bénigne Vénus, le triste Saturne avaient coopéré à sa génération, ce qui explique tout, et les médecins, chirurgiens, sages-femmes, devaient fatalement balancer longtemps à reconnaître son sexe, puisqu’il était né sous le signe de la Balance!
Ces rêveries n’enlèvent rien à l’utilité que put avoir au XVIIe siècle le traité des Hermaphrodits et à l’intérêt qu’il a maintenant encore pour nous; au contraire, elles nous amusent. Le livre nous plairait toutefois davantage, si l’abondance et la confusion d’idées du savant ne faisaient quelque tort à la limpidité de l’écrivain. Jacques Duval commence une phrase avec la meilleure intention du monde, mais il a tant de choses à dire qu’il la perd tout de suite de vue et s’égare, sans l’achever souvent, dans un dédale d’incises et de parenthèses; rarement avons-nous rencontré style plus bizarre et plus embrouillé. N’importe; ce mauvais grammairien fut un brave homme. Sa physionomie, telle que la gravure nous l’a transmise, indique un esprit réfléchi en même temps qu’un grand fonds de bonté; ce sont deux qualités louables, chez un médecin. Il a sauvé la vie d’un pauvre diable et écrit un livre curieux: en voilà assez pour que sa mémoire ne périsse pas complètement.
Juillet 1880.
XVI
LES NOUVELLES
DE BATACCHI52
Les renseignements biographiques font absolument défaut sur Batacchi. Quand nous aurons dit qu’il s’appelait Domenico, qu’il était né à Livourne en 1749 et qu’il mourut, on ne sait où, en 1802, nous aurons épuisé toute notre science et celle des Dictionnaires. Était-il évêque comme Bandello, moine comme Firenzuola, abbé comme Casti, ou simple séculier comme tout le monde? On l’ignore. Ses premiers Contes (Raccolta di Novelle, Londra, anno VI della Republica Francese, 4 vol. in-12) furent publiés, soit en France, soit en Italie, sous le nom du Père Atanasio de Verrocchio et traduits un peu plus tard en Français par Louet, de Chaumont: Nouvelles galantes et critiques, Paris, 1803, 4 vol. in-18. Cette traduction est si mauvaise que la nôtre peut passer pour la première. Dans le préambule d’une de ces Nouvelles, Elvira, il est dit cependant que celle-ci doit être attribuée, non au P. Atanasio da Verrocchio, mais au P. Agapito da Ficheto: ce nous est tout un. Batacchi est, en outre, l’auteur de deux compositions poétiques de plus longue haleine: La Rete di Vulcano, poemo eroi-comico, Sienne, 1779 (1797) 2 vol. in-12, et Il Zibaldone, poemetto burlesco in dodici canti (Londres, 1798, in-8o).
Quel qu’il soit, Batacchi est tout entier dans ses Nouvelles, et notre traduction le fera suffisamment connaître aux lecteurs Français: il mérite de l’être. C’est un conteur jovial, plein de drôleries; le sans façon et la bonne humeur ne peuvent guère être poussés plus loin. Il ne recherche pas les effets de style et les complications d’événements, mais il a de l’invention, de l’originalité, une grande vivacité de dialogue, de mise en scène et, surtout, à un très haut point le sens du grotesque. On s’en aperçoit à la façon dont il comprend des sujets qui ont été traités par d’autres53. Son Prêtre Ulivo n’est que la légende, populaire chez nous, du Bonhomme Misère, que MM. Lemercier de Neuville et Champfleury ont reprise, après maints auteurs de contes et de fabliaux: la palme reste encore à Batacchi pour les détails plaisants. Elvira est l’antique aventure de Combabus mise en vers; la Gageure a été traitée par Grécourt; le Faux Séraphin est une imitation burlesque de l’Ange Gabriel, de Boccace, et l’abbé Casti, qui a voulu aussi reprendre en vers ce joli conte du Décaméron, a été certainement moins heureux, moins original. A l’exemple des auteurs de poèmes chevaleresques, Pulci, l’Arioste, qui aiment à s’appuyer sur des chroniques imaginaires, principalement sur celle du fabuleux Turpin, Batacchi indique aussi les sources où il prétend avoir puisé; c’est tantôt le Turcellino, tantôt un vieux livre imprimé par Alde Manuce, tantôt Bellarmin, Turnèbe, Freinshemius, et ces graves autorités interviennent toujours, chez lui, d’une façon comique. Une autre bizarrerie de ces contes gais: les cocus ont une tendance fatale à se pendre; le malheureux tailleur du Roi Barbadicane et Grâce, le fermier Meo, de la Gageure, mettent fin par la corde à leurs infortunes conjugales; mais, chez Batacchi, la mort elle-même est ridicule.
Si l’on en croyait la Biographie Didot, les Italiens n’apprécieraient guère ce conteur, dont ils considéreraient les productions comme diffamatoires. Cependant, les Poèmes et les Nouvelles ont été plusieurs fois réimprimés et il en a été fait récemment plusieurs éditions populaires; ils ne sont donc pas si oubliés. Pour ce qui est de la diffamation, nous n’y avons rencontré que deux traits piquants à l’adresse d’un certain Cardinal Merciai: Batacchi lui fait rédiger et contresigner la facétieuse bulle Latine du Roi Barbadicane, et dans le Roi Grattafico, ayant à produire sur la scène un saucisson, il lui donne pour enveloppe un sonnet du même Merciai; ces mentions malicieuses n’ont rien de bien méchant. Tout ce que nous conclurons de ces attaques persistantes dirigées contre un haut dignitaire de la Cour Romaine, c’est que Batacchi pourrait bien avoir été lui-même homme d’Église.
Août 1880.
XVII
LES NOUVELLES
DE L’ABBÉ CASTI54
Nous avons eu déjà l’occasion de dire un mot de l’abbé Casti et de son genre de talent poétique en présentant aux lecteurs de la Petite Collection Elzévirienne la traduction de la Papesse55. On trouvera, tant dans notre Avant-Propos que dans la Notice de Ginguené, dont nous l’avons fait suivre, des détails biographiques et des appréciations générales qui feraient ici double emploi. Bornons-nous donc à rappeler ce que sont les Nouvelles galantes et à caractériser brièvement leur mérite littéraire.
La plupart des Conteurs Italiens, Sacchetti, Bandello, Firenzuola, le Lasca, ont écrit en prose, à l’imitation de Boccace, dont le Décaméron semble leur avoir servi de règle et de modèle. Chez nous, au contraire, le conte est presque toujours rimé; nous avons suivi la voie ouverte par nos vieux auteurs de fabliaux. L’abbé Casti, qui vécut longtemps en France et à qui notre langue était plus ou moins familière, s’est approprié le goût Français. Le Conte en vers était, à la fin du XVIIIe siècle, une nouveauté pour les Italiens et, en essayant d’être le premier dans ce genre, où Batacchi seul, son contemporain, lui dispute la palme, Casti voulut aussi s’inspirer, au moins pour la forme, des poèmes chevaleresques; il choisit le mètre héroïque, la stance de huit vers à rimes croisées adoptée par le chantre de la Gerusalemme liberata et qui, par sa structure, par son ampleur, ne peut guère servir de moule qu’à une action suffisamment développée. C’est assez indiquer par quels côtés il s’éloigne de La Fontaine et de Grécourt, dont les récits ont une tournure bien plus brève et bien plus vive; les Nouvelles galantes sont toutes des compositions d’une certaine étendue se rapprochant beaucoup plus de l’épopée badine que du conte, tel que nous l’entendons.
Par leur cadre, par les sujets qui y sont traités, on peut les diviser en trois ou quatre catégories, parmi lesquelles nous n’avons pas fait porter indifféremment le choix que nous nous proposions de faire. Il y a d’abord les poèmes mythologiques; nous les avons écartés tous, si gracieux et si plaisants qu’ils soient le plus souvent; le goût n’est plus aujourd’hui à ce genre de compositions galantes que chez nous Parny et Lemercier, dans ses Quatre Métamorphoses, ont pour ainsi dire épuisé. Viennent ensuite d’assez nombreux morceaux où l’auteur s’est proposé de reprendre à sa façon des sujets déjà mis en œuvre par Boccace ou par La Fontaine; le Rossignol, le Purgatoire, l’Ange Gabriel, la Jument du Compère Pierre, les Culottes de Saint François, etc.; mais ces deux maîtres ont imprimé à tout ce qu’ils ont touché une forme trop définitive pour que l’infériorité de l’abbé Casti ne soit pas manifeste, surtout à travers le voile d’une traduction.
Quant aux sujets historiques, il les a généralement traités d’une manière intéressante; l’Origine de Rome, l’Apothéose, où il retrace les infortunes conjugales de Marc-Aurèle, les Mystères surtout, qui ont pour objet la fameuse aventure de Claudius surpris avec la femme de Jules César, sont des poèmes fort remarquables; mais la Papesse peut donner une idée suffisante de l’art avec lequel il sait mêler l’enjouement aux choses sérieuses.
Nous avons choisi, entre toutes, celles de ses Nouvelles qui, par l’action comme par les détails, sont de sa propre invention, celles qui révèlent l’originalité du conteur et les mérites de l’écrivain. Casti est un abbé Voltairien; sceptique à l’endroit des choses de la foi, il manque rarement l’occasion de s’en moquer d’une façon légère et spirituelle; c’est aussi un poète dont l’imagination a de la fraîcheur et le style du coloris; un vieillard resté jeune, amoureux de la femme, dont il excelle à rendre le charme et les séductions; un satirique sans amertume, joignant à une grande finesse d’observation la bonhomie railleuse de l’Épicurien. Les Nouvelles dont nous avons fait choix permettront d’apprécier quelques-unes des qualités de cet esprit aimable et enjoué.
Août 1880.